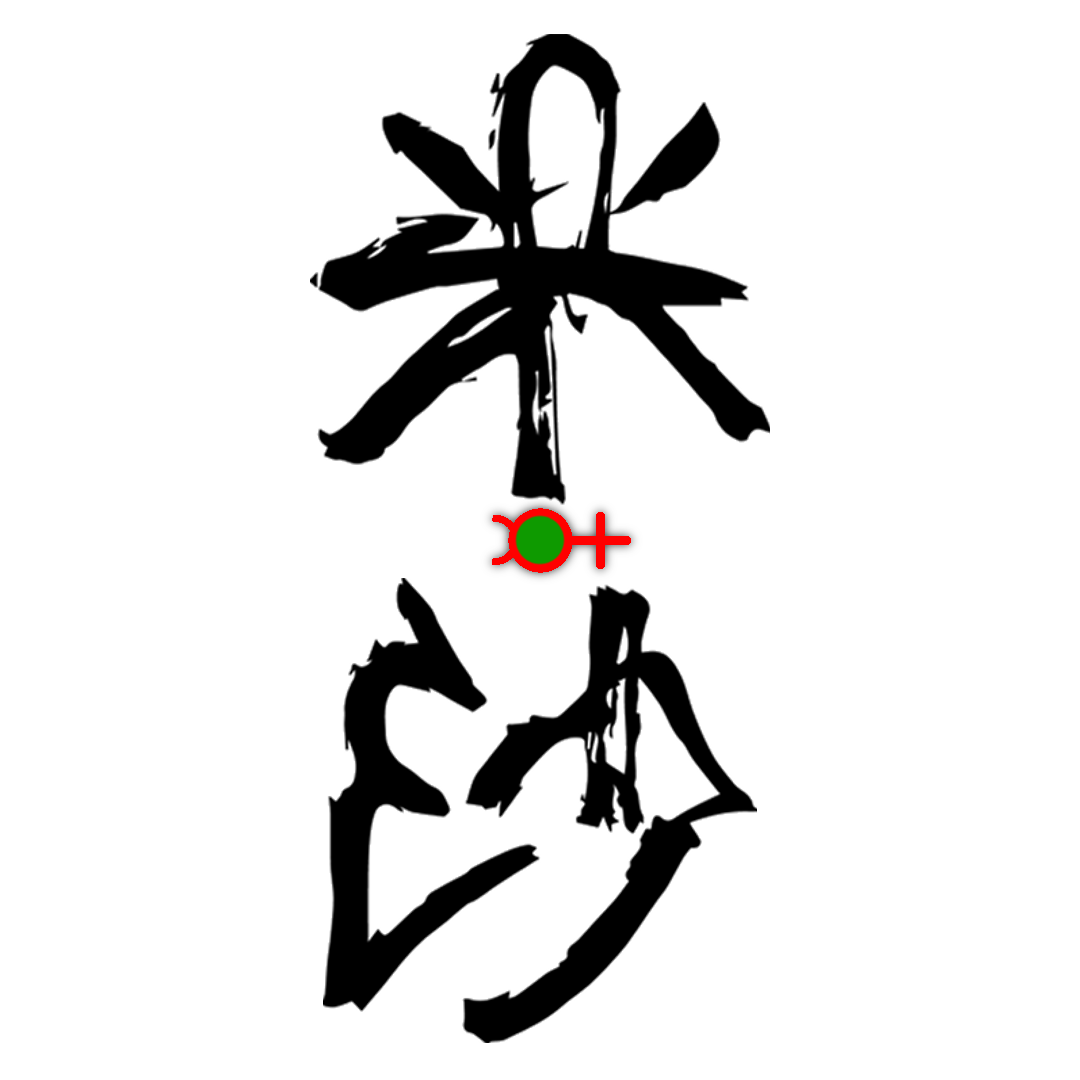Programme de français Misha Schroetter
Bienvenue sur ma page consacrée au programme de français de troisième au collège.
Sur cette page, vous aurez accès au programme de français que j’ai compilé
afin de donner des cours. Cette page est dédiée principalement aux élèves de troisième
qui assistent à mes cours.
Pourquoi avoir fait une page internet et non un simple document Word, ou un PDF ?
Pour la simple raison que ces documents prennent de la place. Sur papier, mais
aussi dans nos boites mail, et sur les différentes plateformes, serveurs, etc. hébergés
sur des appareils physiques, des « machines », qui participent au réchauffement climatique
et qui sont, bien souvent, mal gérées.
De plus, cette page ne sera hébergée qu’une seule fois sur internet, c’est-à-dire,
localement, sur mon propre serveur physique. L’accès est aussi facilité pour tous élèves qui auraient besoin
de consulter mes cours de français.
Enfin, j’ai beau essayer d’utiliser des logiciels de traitement de texte,
qui sont presque toujours imposés par les institutions scolaires, ou universitaires,
ils ne permettent jamais de maîtriser le code permettant l’affichage du texte,
et son organisation. Par exemple, sur cette page, je peux facilement ajouter des éléments
interactifs à ce texte
Site de Wikipédia
Par exemple avec cette
sidenote, qui me permet d’insérer des liens vers d’autres pages web, et
de créer une forme d’interactivité, visuellement sympathique et pratique, sur version
mobile.
Sommaire
Introduction
Les auteurs
Les auteurs vus dans le programme de français de troisième :
Jacques Lusseyran
Frise chronologique
En cliquant sur ce lien, vous trouverez une frise chronologique de l’Histoire de la littérature française.
Cette frise est à consulter avec discernement à propos de son contenu. En effet, elle vous donnera
un visuel et une ergonomie très simple à lire et employer.
Site frise chronologique de la littérature française
Cours de Français 3e
Programme de français 3e
Culture littéraire et artistique
Se raconter, se présenter
L’autobiographie
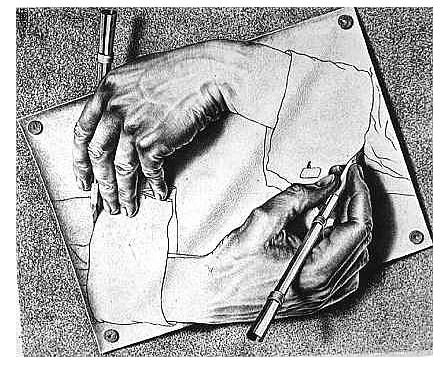
L’origine du genre
n. f. Du grec auto. « soi-même », bios, « vie », et graphien, « écrire ».
L’autobiographie
Autobiographie
Voir une autre définition sur Wikipédia. est un genre littéraire dans lequel un auteur écrit le récit de sa vie
propre
Le genre littéraire
Définition de « genre » ou qu’est-ce qu’un genre littéraire sur Wikipédia..
C’est Jean-Jacques Rousseau
Jean-Jacques Rousseau
Portrait de l’auteur.
qui fut considéré le premier auteur autobiographique avec ses
Confessions. Ce genre littéraire est moderne. Rousseau écrira dans
l’incipit de son livre :
« Je forme une entreprise qui n’eut jamais d’exemple et dont l’exécution n’aura point d’imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet homme ce sera moi. »
Ce genre fut nommé « autobiographie » a posteriori, c’est-à-dire, plusieurs années après la parution, à titre posthume, de l’œuvre, déterminant une histoire individuelle de l’écrivain, plutôt que sur une histoire collective.
Spécificités de l’autobiographie
C’est Philippe Lejeune
Philippe Lejeune
Portrait de l’auteur. qui définira plus précisément ce que sera l’autobiographie dans son
ouvrage : Le Pacte autobiographique en 1975. Il le définira comme un :
« (…) récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité« .
L’autobiographie se distingue donc d’autres genres comme : les mémoires, le journal, l’autoportrait
et l’autofiction. Mais comme ils relèvent tous de l’écriture du moi, ils
sont tout de même considérés « autobiographiques ».
Les mémoires ne sont pas rétrospectifs, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas vocation à être
forcément précis, ou historiques. Dans l’autofiction, que nous verrons un peu plus loin, c’est une
autre forme de pacte qui est proposé aux lecteurs, le pacte fictionnel, précisant que l’ouvrage est
un roman, et donc que l’auteur inventera certains éléments qu’il écrira dans ce livre.
C’est le pacte de vérité qui est proposé comme « contrat » implicite entre l’auteur et le
lecteur, selon Lejeune, pour préciser ce que sera une autobiographie. Ce « pacte » symbolisera une
promesse de l’auteur, de s’engager à dire la vérité dans son ouvrage.
L’autofiction
Ou roman personnel est un sous-genre de l’autobiographie qui propos une vision romancée
ou fictionnelle de faits réels que l’auteur aura vécu lui-même et qu’il écrira lui-même,
comme dans l’autobiographie. C’est Serge Doubrovsky qui créera le mot « autofiction », complétion de
deux mots : l’autobiographie et la fiction
Définition de « fiction »
Article de Wikipédia..
Un mouvement littéraire important du XXe siècle, nommé le Nouveau Roman créa une réaction
chez certains auteurs qui ne voulaient pas s’y joindre. Pour mieux comprendre la création de l’autofiction
il faudrait passer un certain temps à regarder un courant de pensée du milieu du XXe siècle :
le structuralisme
(lien vers le cours de philosophie de terminale).
Pour résumé brièvement, les « nouveaux romanciers » du XXe siècle optèrent pour une approche plus
analytique et froide de leurs écrits, où la psychologie et la culture, ainsi que les structures
des histoires devaient être employé pour créer une forme de « control » intellectuel de l’écrit. Le sujet,
l’Homme, fut en quelque sorte tué à cette époque, pour le remplacer par des schémas de pensée humaine.
L’autofiction, en plus de créer le pacte fictionnel, qui déterminera la nature de ce qu’ils écrivent,
c’est-à-dire, basé sur des faits, mais romancés, choisissent aussi de remettre l’inspiration au service
de l’écriture. L’inspiration et la création artistique leur permirent de rendre les faits plus vrai
que nature, plus vivant et donc de mieux les transmettre.
Enfin, l’autofiction critiqua l’autobiographie dans son caractère « véridique » et parlant
d’illusion de transparence. Car tout écrit est et sera subjectif,
peu importe le pacte, jamais un écrit ne pourra être objectif, donc pourquoi ne pas embrasser ce fait
scientifique et artistique ?
I- Le pronom personnel « je »
Lecture
« J’ai rencontré des êtres surprenants, des êtres pathétiques et dont l’éclat des gestes et des paroles était tel qu’on était contraint, en leur présence, de baisser les yeux. Jérémie n’était pas surprenant. Oh ! Pas le moins du monde ! Il n’était pas là pour nous troubler.
Ce n’était pas la supériorité qui me jetait vers lui. J’avais besoin de lui comme un homme qui meurt de soif a besoin d’eau. Comme toutes les choses importantes, celle-là était élémentaire.
Je vois Jérémie marchant à travers notre baraque. Il y avait un espace qui se formait entre lui et nous, matériellement. Il s’arrêtait quelque part et, tout de suite, des hommes se serraient davantage, lui donnaient une petite place au milieu d’eux. C’était un mouvement tout instinctif et qu’on ne peut pas expliquer par le seul respect. Nous reculions plutôt comme on fait un pas en arrière pour laisser la place à celui qui travaille.
Songez que nous étions plus de mille hommes dans cette écurie de campagne, mille hommes là où quatre cent eussent été mal à l’aise. Songez que nous avions tous peur, profondément et immédiatement. Ne pensez pas à nous comme à des individus, mais comme à une glu, comme à une masse protoplasmique. En fait, nous étions collés les uns contre les autres. Les seuls mouvements que nous faisions consistaient à pousser, à s’agripper, à se dépendre, à sinuer. Et vous comprendrez mieux la merveille (pour ne pas dire le miracle) de cette petite distance, de ce cercle d’espace dont Jérémie restait entouré.
Il n’était pas effrayant, il n’était pas austère, il n’était pas même éloquent. Mais il était là, et cela se voyait. Cela se sentait comme on sent une main se poser sur l’épaule, une main qui rappelle, qui fait se retourner quand on était en train de fuir.
Chaque fois qu’il paraissait, l’air devenait respirable : je recevais un souffle de vie en pleine figure. Ce n’était peut-être pas un miracle, mais c’était du moins une bien grande action et dont il était seul capable. La promenade de Jérémie à travers le bloc, c’était cela : une respiration. Je suis distinctement dans ma mémoire le chemin de lumière et de propreté qu’il faisait à travers la foule Extraits de Le monde commence aujourd’hui, réédition aux éditions Silène, 2012. p. 29-30.. »
Questions
Retrouvez l’emploi du pronom personnel « je » dans le texte et décrivez quand il est utilisé et à quels temps :
au passé, au présent ?
Remarquez s’il n’y a pas d’autres pronoms personnels, si oui, à qui s’adressent-ils ?
Que pensez-vous de Jérémie et de la réaction de Jacques Lusseyran ?
Lexique français
Le genre littéraire
Le mot « genre » nous vient du latin genus ou generis : « genre, sorte, espèce, race,
famille, origine ».
Au XXe siècle, le genre est communément employé pour définir une identité féminine, masculine,
ou encore féminino-masculine, neutre, etc. Cette définition nous vient de l’anglais gender et
s’est popularisé récemment comme un fait de société.
« Catégorie générale d’œuvres littéraires ou artistiques définie par plusieurs caractéristiques : sujet, style, usage de la prose ou du vers, règles de structure… » La littérature de A à Z, Hatier.
C’est à l’antiquité que les genres apparaissent afin de cataloguer les des ouvrages selon des
règlements faits par les auteurs, les critiques et le public. La notion de genre fut importante
pendant longtemps, par exemple à l’âge classique (VIIe siècle), dans une forme de hiérarchisation de
ceux-ci. Certains genres étaient plus « nobles » que d’autres plus « populaires ».
Mais au XXe siècle, ces catégories s’estompèrent, et ne resta que des manières de classer les œuvres
selon les différents styles ou tonalités de celles-ci (les essaies, les romans, le théâtre …). C’est
donc surtout l’idée de hiérarchie qui tant à disparaître, même s’il existe encore des institutions qui
séparent certains auteurs, par exemple en leur donnant toujours le qualificatif d’œuvre « littéraire »,
contre des ouvrages, par exemple de science fiction, considérés comme « populaire » ou « fantaisistes ».
Jacques Lusseyran

Jacques Lusseyran est né le 19 septembre 1924 à Paris 18e et mort le 27 juillet 1971 à Saint-Géréon
en Loire-Atlantique1. Aveugle depuis l’âge de 8 ans il était un résistant français, responsable au
sein des mouvements Volontaires de la Liberté puis de Défense de la France. Il fut déporté à Buchenwald
en 1944 jusqu’en 1945 et il fut, par la suite, professeur de littérature et de philosophie
aux États-Unis.
Jacques Lusseyran
Article de Wikipédia.
Jacques Lusseyran est un auteur extraordinaire. Si je l’ai choisi pour le programme de littérature,
c’est pour plusieurs raisons. La première est qu’il est inspirant, sa vie est inspirante. Ensuite,
le fait que son écrit : Le Monde Commence Aujourd’hui soit une autobiographie, colle bien avec
notre programme de troisième, mais plus que cela, dans cet écrit, la poésie est présentée comme jamais
elle ne l’a été par aucun auteur que je connaisse. C’est-à-dire que, dans cet ouvrage, l’auteur
détaille le moment de sa vie où il fut déporté, et en tant qu’aveugle, son approche de l’écoute des
autres, et comment lui-même s’exprime est très imprégné de sensibilité, c’est-à-dire, de ses sens.
La poésie sera un des sujets que nous devrons aborder dans le programme scolaire cette année.
Dans cet ouvrage, Jacques Lusseyran décriait comment il réagit à la poésie, lui-même, dans un point de
vue subjectif et étant le narrateur. Il décrira alors le ressenti que ses congénères vécurent à l’écoute
et à la prononciation de poèmes lorsqu’ils avaient faim, froid, et qu’ils étaient désespérés.
« (…) Il ne me restait en mémoire qu’un poème de Baudelaire : La Mort des Amants. Je le donnai. Et des dizaines de voix ronflantes, grinçantes, croassantes, caressantes répétèrent : « des flammes mortes »… Je sais que c’est à peine croyable, mais, derrière moi, j’entendis des hommes qui pleuraient.(…) Non la poésie, ce n’était pas de la littérature, pas seulement. Cela n’appartenait pas au monde des livres. Cela n’était pas fait pour ceux-là seuls qui lisent. Les preuves se multipliaient. (…) Il était une chose que seule la terreur pouvait obtenir, c’était que ces centaines d’hommes bouillonnant au fond de la baraque fissent silence. Seule la terreur… et la poésie. Si quelqu’un récitait un poème, tous se taisaient, un à un comme des braises s’éteignent Extraits de Le monde commence aujourd’hui, réédition aux éditions Silène, 2012. p. 86-96.. »
Ici un extrait d’un entretien de Jacques Lusseyran :
Lien vers France Culture
Vous aurez compris, nous analyserons ensemble, lors de ce cours, Le Monde Commence Aujourd’hui,
en le lisant chacun de notre côté, à la maison, et séance, après séance, nous reviendrons dessus.
Vous comprendrez, avec cet ouvrage, je l’espère, un certain pouvoir des mots et de la poésie. J’espère
aussi que le contexte historique (seconde guerre mondiale) et la dimension autobiographique vous
inspireront.