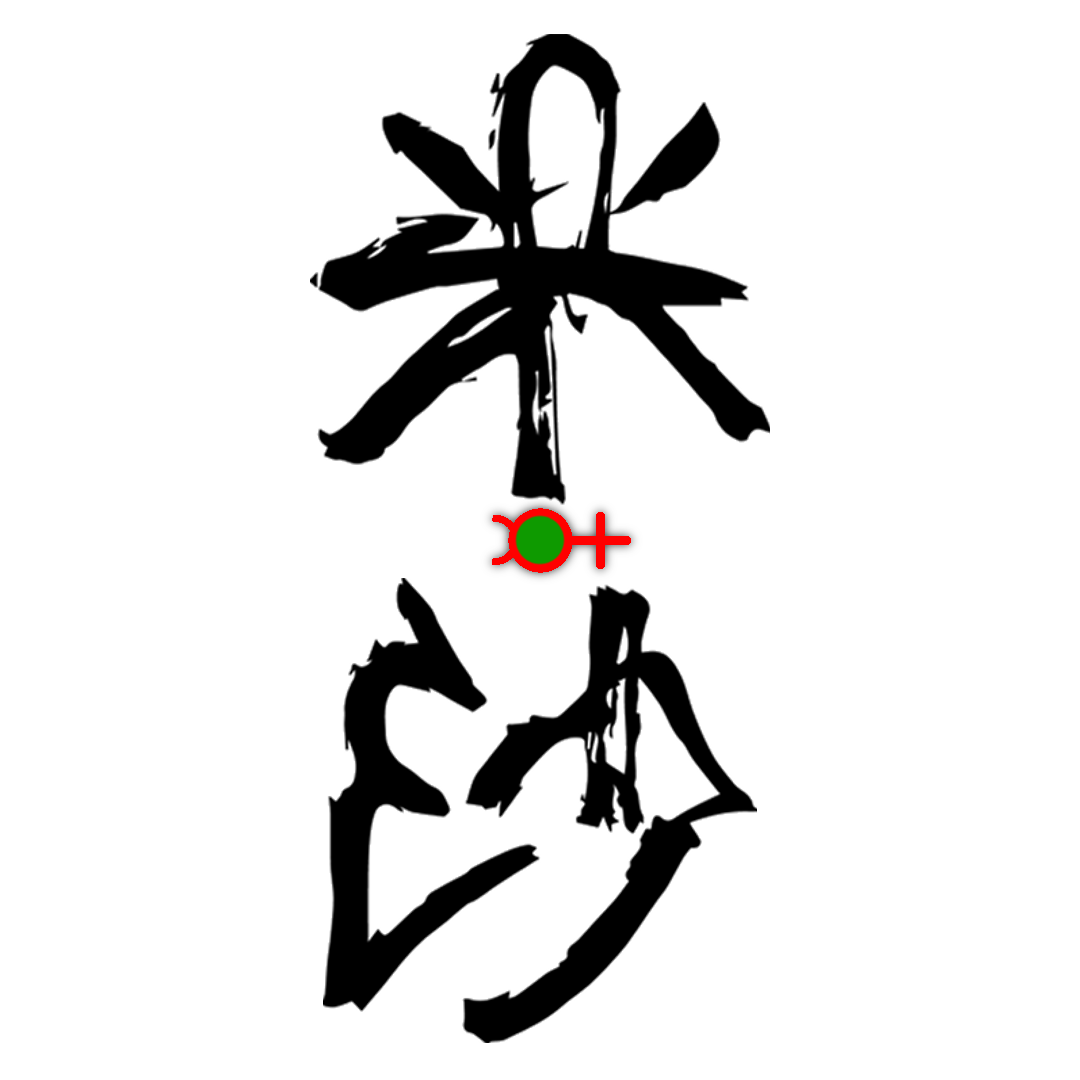Qu’est-ce que le culturalisme
« L’expression « théorie culturaliste de la personnalité », en abrégé « culturalisme », fut employée pour la première fois dans les années 1950-1960 à propos des travaux américains sur les rapports entre culture et personnalité. »1
Les premiers de ces travaux remontent aux années trente (Mead, 1928 ; Benedict, 1935).
« L’anthropologie hérite des deux grandes questions ontologiques que nous a laissé en partage l’âge théologique lors de sa reddition sous le tir nourri des Lumières. D’où venons-nous ? Pourquoi sommes-nous différents, autrement dit, pourquoi y a-t-il de la diversité culturelle ? La première question, qui renvoie aux mésaventures d’Adam et Ève, se trouva résolue assez rapidement grâce à l’introduction d’une généalogie alternative biologique faisant descendre l’humain du singe. Cette séquence déjà vieille de presque deux siècles n’a eu de cesse d’être améliorée ou réinventée par les paléontologues et les anthropologues physiques, mais n’a jamais été remise radicalement en cause. Quant à la question de la diversité culturelle, elle était posée durant l’âge théologique sous la forme de la diversité linguistique. C’est la malédiction de la tour de Babel, partiellement levée par la Pentecôte, autrement dit par le coup d’envoi de l’œuvre apostolique, celle de la diffusion de la parole de Dieu dans toutes les langues humaines. Il s’agissait, d’un point de vue théologique, d’une mise à l’épreuve de la détermination missionnaire du bon chrétien. Il lui fallait se mettre lui-même à l’épreuve pour étudier et maîtriser ainsi des langues exotiques – dont les difficultés intrinsèques sont bien œuvre divine – de sorte que puisse se diffuser l’Évangile (la « bonne nouvelle ») parmi toutes les populations de la terre. Du coup, la question de la diversité culturelle en tant telle a longtemps été enfouie sous celle de la diversité linguistique. Comme l’a fait remarquer Lévi-Strauss à plusieurs reprises, aux yeux de l’Europe du xvi e siècle, les costumes et les mœurs des hommes exotiques n’avaient rien de si extraordinaire que cela. Tout était déjà dans Pline. »2

« (…) nous voyons clairement deux options se dessiner parmi les élèves de Boas, à savoir d’un côté, l’école dite Culture and Personality emmenée par Ruth Benedict et, de l’autre, le diffusionnisme de Wissler et de Kroeber.
À première vue, au regard de Culture and Personality, le rôle de Boas apparaît surtout comme celui d’un passeur de la tradition allemande, puisqu’on peut déceler dans l’œuvre de Benedict et la notion de Pattern of Culture3 une résurgence de la psychologie des peuples que nous avons déjà évoquée, serait-elle revigorée par la psychanalyse à la mode jungienne. Au demeurant, le géologisme propre à Boas – lequel voit dans chaque culture localisée un conglomérat de savoirs, de croyances, de représentations du monde, de règles sociales et de comportements hérités d’un passé dépouillé de marques historiques intangibles, le tout traduit et véhiculé par une langue spécifique – permet de faire bon accueil à l’idée selon laquelle les composants fondamentaux d’une culture donnée relèvent d’un inconscient caché. »4
Qu’est-ce que l’inconscient ?
La question de l’inconscient sous-entend toujours la question de la conscience. L’inconscient serait ce qui n’est pas conscient et la conscience vient elle-même du mot science et du préfixe « con », qui veut dire avec. L’étymologie est latine : conscientia, composé de « com », avec et « scire » savoir ou connaissance.
Je ne vous apprendrai rien en vous disant que l’inconscient est un concept employé dans la psychanalyse ainsi que dans les psychothérapies. Mais l’inconscient fut pensé premièrement dans la philosophie, et c’est dans ce sens-là que l’anthropologie reprendra cette notion dans le culturalisme. Levi-Strauss disait :
«Ainsi, l’appréhension (qui ne peut être qu’objective) des formes inconscientes de l’activité de l’esprit conduit tout de même à la subjectivation ; puisqu’en définitive, c’est une opération du même type qui, dans la psychanalyse, permet de reconquérir à nous-même notre moi le plus étranger, et, dans l’enquête ethnologique, nous fait accéder au plus étranger des autrui comme à un autre nous. Dans les deux cas, c’est le même problème qui se pose, celui d’une communication cherchée, tantôt entre un moi subjectif et un moi objectivant, tantôt entre un moi objectif et un autre subjectivé.» 5
La grammaire permet de comprendre précisément les mots de Claude Levi-Strauss. « (…) accéder au plus étranger des autrui comme à un autre nous. » C’est bien le propre de l’anthropologie et des méthodes ethnographiques qui arrivent avec le culturalisme comme nouveau paradigme anthropologique.
Définition : Paradigme :
« Selon l’usage habituel, un paradigme est un modèle ou un schéma accepté, et cette signification particulière m’a permis de m’approprier ici ce terme, à défaut d’un meilleur. (…) Dans une science, au contraire, un paradigme est rarement susceptible d’être reproduit : comme une décision judiciaire admise dans le droit commun, c’est un objet destiné à être ajusté et précisé dans des conditions nouvelles ou plus strictes. »6
Pour revenir à la citation de Lévi-Strauss, « autrui », l’autre, mais « autre nous » qu’est-ce que ce serait ? C’est une part inconsciente de nous même. « Ainsi, l’appréhension (qui ne peut être qu’objective) des formes inconscientes de l’activité de l’esprit », cela veut dire qu’appréhender l’inconscient, c’est le rendre objectif, car c’est le mettre en lumière, en le rendant conscient. Le subjectif serait alors à l’objectif ce que l’inconscient est au conscient. Ce qui veut dire qu’une part de nous-mêmes est inconscient, mais que nous pouvons prendre conscience de cette partie obscure de notre esprit, et par la même, faire de même avec l’esprit des « autres ». Enfin : « (…) tantôt entre un moi subjectif et un moi objectivant, tantôt entre un moi objectif et un autre subjectivé. » Le moi subjectivant est alors un moi qui prend le temps de prendre conscience de ses schémas inconscients, et le moi devenu objectif découvrira un autre subjectivé, chez l’autre, ou dans un inconnu intérieur inconscient, reflet vu chez l’autre.
Il faut remettre dans son contexte l’élaboration progressive du courant culturaliste, ou autrement dit : de « la théorie culturaliste de la personnalité ». Notre premier extrait nous parle de Karl Gustave Jung et sa psychanalyse. Ce qui deviendra la psychanalyse jungienne s’appuie sur les travaux de Jung, qui ne voulait surtout pas faire école (d’où le paradoxe de se dire jungien). Mais, ce sont les notions « d’inflation mentale », « d’individuation », « d’inconscient collectif », de « synchronicité » et j’en passe, qui sont des notions élaborées par Jung et sa recherche sur le symbolisme aux quatre coins du monde qui auraient pu influencer un courant comme celui du culturalisme.
« Le culturalisme au sens large n’est pas une théorie mais une façon équivoque de raisonner sur la culture considérée comme un tout. (…) on vit dans une civilisation, on acquiert une culture. Ce qui rend difficile l’usage du mot « culture », c’est qu’il institue une relation entre l’état d’une tradition, d’un acquis social, et un procès individuel d’acquisitions intellectuelles et morales. (…) R. Benedict (1935), par exemple affirme que l’individu est entièrement modelé (patterned) par la culture à laquelle il appartient et dont il serait en quelque sorte la création. »7
Qui était Ruth Benedict ?

Ruth Futon Benedict est née en 1887 à New York et y est décédée en 1948. Elle étudia l’anthropologie à la New School for Social Research, toujours à New York en 1919-1922. En 1922-1923, elle devient l’assistante de Franz Boas à Barnard College. En 1922, elle connaît une première expérience de terrain chez les Serano du sud de la Californie ; puis chez les Pima et les Pueblos du Sud-Ouest.
Elle fut très influencée par la psychanalyse américaine et toujours d’après le dictionnaire d’anthropologie, elle proposa dans Patterns of culture (1934) une typologie des cultures s’appuyant sur « des catégories empruntées à la psychopathologie et sur la distinction faite par Nietzsche dans L’origine de la tragédie entre caractère apollinien et caractère dionysiaque. »8
Définition : L’apollinisme :
« L’apollinisme caractérise le principe d’individuation, c’est-à-dire la tendance de la vie (par essence artiste) à se donner une forme définie et achevée. La perfection plastique incarnée par Apollon nous renvoie au monde heureux des belles apparences, aux illusions du rêve. Mais cet univers lumineux se détache sur le fond d’un monde dionysiaque, dont il constitue le plus beau et le plus parfait mensonge. »9
Définition : L’ivresse Dionysiaque :
« L’ivresse dionysiaque est bien ce moment, pour Nietzsche, où l’identité individuelle se perd, pour se plonger, s’abîmer dans la fusion avec une totalité cosmique en délire. Parce qu’il est un sentiment cosmique, le dionysiaque renvoie à l’essence même du monde de la volonté de puissance : un monde en perpétuel mouvement, en lequel toutes les formes se nouent et se dénouent, se créent et se défont sans cesse. C’est sur ce fond obscur et déchiré que se dessinent les formes lumineuses, aux contours nets et finis, des fictions apolliniennes. »10
Ces définitions sont philosophiques, mais l’anthropologie est un enfant direct de la philosophie, non une branche de la sociologie avec laquelle elle partage pourtant beaucoup de points communs. Apollon et Dionysos sont des Dieux Greco-Romain, qui représentent des entités, des caractères, interprétées comme des références psychologiques par Jung dans ses recherches :
« Nous sommes possédés par nos contenus psychiques autonomes exactement comme s’ils étaient des dieux. On les appelle maintenant phobies, impulsions, etc., bref, symptômes névrotiques. Les dieux sont devenus des maladies : Zeux ne régit plus l’Olympe, mais le plexus solaire et il crée des cas pour le cabinet du médecin, (…). »11
Que Benedict emprunte à Nietzsche l’idée de distinguer les figures d’Apollon et de Dionysos fut considéré comme surfait, et on lui reprocha un réductionnisme psychologique dans son étude comparée des Pueblos, de Dobu (Nouvelle-Guinée) et des Kwakiutl (Côte nord-ouest), malgré qu’il devint un classique de l’anthropologie américaine.
- Safietou Diack
- Type apollinien :
-
Sociétés produisant des individus conformistes, attachés aux rituels, aux apparences et opposés à toute expression excessive des émotions.
- Type dionysiaque :
-
Sociétés caractérisées par l’individualisme, la violence, l’agressivité, l’expression des émotions y sont valorisés.
Lors de la grande dépression, Ruth Benedict s’intéressa à sa propre société en travaillant sur une anthropologie appliquée à l’étude des problèmes sociaux contemporains. Après cela, la Seconde Guerre mondiale fut déclarée, et Benedict, comme Mead et Bateson furent des scientifiques très engagés pour la défense des idéaux démocratiques de l’Occident.
“A culture, like an individual, is a more or less consistent pattern of thought and action. […] Each people further and further consolidates its experience, and in proportion to the urgency of these drives the heterogenous items of behaviour take more and more congruous shape. […]
Such patterning of culture cannot be ignored as if it were an unimportant detail. The whole, as modern science is insisting in many fields, is not merely the sum of all its parts, but the result of a unique arrangement and interrelation of the parts that has brought about a new entity. Gunpowder is not merely the sum of sulphur and charcoal and saltpeter, and no amount of knowledge even of all three of tis elements in all the forms they take in the natural world will demonstrate the nature of gunpowder.”12
Traduction :
« Une culture, comme un individu, est un modèle plus ou moins cohérent de pensée et d’action. […] Chaque personne consolide de plus en plus son expérience, et en proportion de l’urgence de ces moteurs, les comportements hétérogènes prennent des formes de plus en plus précises (congrues). […]
Une telle modélisation de la culture ne peut être ignorée comme s’il s’agissait d’un détail sans importance. Le tout, comme l’affirme la science moderne dans de nombreux domaines, est loin d’être la somme de tous ses ingrédients, mais le résultat d’un arrangement et d’une interrelation uniques de toutes ses parties qui a donné naissance à une nouvelle entité. La poudre à canon n’est pas simplement la somme du soufre, du charbon de bois et du salpêtre, et aucune connaissance, même, de ces trois éléments sous toutes les formes possibles qu’ils prennent dans le monde naturel ne démontrera la nature de la poudre à canon. »13
Margaret Mead

Anthropologue américaine née à Philadelphie en 1901. En 1921, elle suivit des études de psychologie et d’anthropologie à l’université de Columbia formée par Franz Boas et Ruth Benedict. Son premier terrain connu fut à Samoa en 1925, puis dans les îles de l’Amirauté entre 1928 et 1929. Elle écrira deux ouvrages tirés de ces terrains : Coming of Age in Samoa (1927) et Growing up in New Guinea (1930).
« S’attachant à relier les caractéristiques psychologiques des individus aux conditions et expressions particulières des cultures océaniennes qu’elle a étudiées, à leurs méthodes et à leur cadre d’éducation, elle y remet en cause – en même temps que la notion de mentalité prélogique (Lévy-Bruhl) et le rapprochement entre mentalité primitive et mentalité enfantine (Freud) – l’universalité des troubles qui accompagnent la période de l’adolescence. »14
Définition : Mentalité prélogique de Lévi-Bruhl :
« Ce mot, assez mal choisi, il faut l’avouer, a donné lieu à des malentendus tenaces, extrêmement difficiles à dissiper. Il n’implique pas (…) que les esprits des primitifs soient étrangers aux principes logiques : conception dont l’absurdité éclate au moment même où on la formule. Prélogique ne veut pas dire alogique, ni antilogique. Prélogique, appliqué à la mentalité primitive, signifie simplement qu’elle ne s’astreint pas avant tout, comme notre pensée, à éviter la contradiction. Elle n’a pas les mêmes exigences logiques toujours présentes. Ce qui à nos yeux est impossible ou absurde, elle l’admettra parfois sans y voir de difficulté. »15
Freud reprendra lui aussi les idées de Lévi-Bruhl, mais différemment et dans une vision psychanalytique. Ce qui est important de retenir sur le constat de Mead à propos des concepts psychologiques qui lui sont contemporains, c’est qu’elle a pu les remettre en question grâce à ses ethnographies. Le dictionnaire d’ethnologie ajoute :
« Dans la perspective de Mead, les méthodes d’éducation, la structure de la personnalité adulte, les orientations fondamentales de la culture forment un ensemble organisé et indissociable dont l’étude invite à repenser la place de ce qui est de l’ordre du « naturel » au sein de chaque culture. »16
Pour conclure à propos de Margaret Mead, voici une citation que j’ai trouvée dans un de ses ouvrages :
« In contrast to our own social environment which brings out different aspects of human nature and often demonstrated that behavior which occurs almost invariably in individuals within our society is nevertheless due not to original nature but to social environment; and a homogeneous and simple development of the individual may be studied. »17
Traduction personnelle :
« En contraste avec notre propre environnement social, lequel on en ressort différents aspects de la nature humaine et qui souvent démontre que le comportement est le résultat presque invariable des individus qui n’est pas dus à une nature originelle, mais à l’environnement social ; et un développement simple et homogène de l’individu est préférable d’avoir été étudié. »
Les limites du culturalisme
Trois modèles traditionnels du culturalisme
- Description
-
Les pratiques sociales qui doivent être décrites en même temps que les statuts et les rôles.
- Discours
-
Les commentaires que font les gens, les interprétations qu’ils en donnent.
- Effets psychologiques
-
Les effets psychologiques à examiner par des méthodes spécialisées, pour autant qu’on puisse le faire sans oublier les messages. (Dictionnaire Bonte et Izard)
« Une pratique peut avoir des effets et des conséquences, mais attribuer à la culture une efficacité causale revient à supposer que les recettes de cuisine nous dispensent de manger. »18
Melville Herskovits

-
Melville Herskovits s’intéresse à la diversité de la société américaine : communauté d’origine européenne, d’origine africaine, amérindienne. Voir Melville Herskovits (1895-1963) sur les Afro-Américains et leur lien à l’Afrique in Héritage du noir : entre mythe et réalité (édition française en 1966). L’attention portée aux rapports entre ces différentes communautés et aux formes de leurs contacts, permet l’étude du phénomène de l’acculturation dans un contexte de ségrégation raciale.
- Définition acculturation
-
« Le terme d’acculturation désigne les processus complexes de contact culturel au travers des sociétés ou des groupes sociaux assimilent ou se voient imposer des traits ou des ensembles de traits provenant d’autres sociétés. Ce terme appartient au vocabulaire de l’école dite « culturaliste » (cf. notamment Herskovits, 1958, 1967) et, plus généralement, de la pensée ethnologique des années cinquante. »19
ad- (“Du grec ancien a-, a- exprimant la privation.”) + culture + -ation (“un processus”).
Herskovits est un anthropologue américain né en 1895 et mort en 1963. Il étudia l’anthropologie à l’université de Columbia (encore un), suivant les enseignements de A. Goldenweiser, E. C. Parsons, T. Veblen et surtout de Franz Boas. En 1927, il créa le premier programme américain d’étude africaine à l’université de Northwestern, Evanston. Il finira par être titulaire, en 1961, de la première chaire d’étude africaine créée aux États-Unis. Dans son étude du changement culturel, « On lui doit surtout à ce tenant du relativisme culturel d’avoir ouvert la voie à l’étude scientifique des Noirs du Nouveau Monde. »20
Les recherches de Herskovits sont très importantes pour l’anthropologie que l’on appelle « africaniste », autant dans ses études des communautés noires aux États-Unis, qu’au Brésil, mais aussi ses nombreux terrains sur le continent africain : au Dahomey (Bénin 1938), et à Haïti (1937) et Trinidade (1947).
Trois notions clés dans les analyses de Herskovits
- Africanisme
-
L’africanisme est le nom que l’on donne à l’anthropologie qui étudie les sociétés en lien avec le continent africain. Cette appellation date du tout début de l’anthropologie, avec la colonisation, mais l’africanisme n’a cessé d’évoluer avec la discipline anthropologique. Cette anthropologie est riche de sa diversité de terrain, et s’est petit à petit tellement diversifiée qu’il est aujourd’hui difficile de parler d’africanisme. Les terrains ne sont pas uniquement faits sur le sol africain, mais comme avec Herskovits, sur le territoire américain, du nord et du sud. L’étude des communautés d’origine africaine sur des territoires hors du continent africain fait partie des objets d’étude de cette catégorie de l’anthropologie.
- Synchétisme
-
« (…) amalgame d’éléments mythiques, culturels ou organisationnels de sources diverses au sein d’une même formation religieuse. (…) Le syncrétisme est désormais reconnu comme un processus contre-acculturatif impliquant manipulation de mythes, emprunt de rites, association de symboles, inversion sémantique parfois et réinterprétation du message christique. »21
- Réinterprétation
-
D’après Jean-François Sirinelli, cité par Jean-Pierre Rioux, « l’histoire culturelle est celle qui s’assigne l’étude des formes de représentations du monde au sein d’un groupe humain dont la nature peut varier – national ou régional, social ou politique – et qui en analyse la gestation, l’expression ou la transmission »22
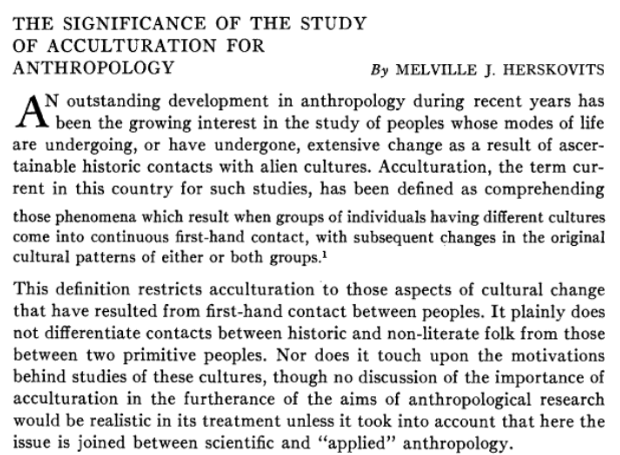
Je ne vais pas tout traduire, mais la partie la plus intéressante selon moi :
« Cette définition restreint l’acculturation à ces aspects de changements culturels qui furent le résultat d’un contact de première main entre des peuples. C’est pauvrement que cette définition ne différencie pas les contacts entre des populations dont on a une histoire (écrite) et ceux qui n’en ont pas, et entre deux peuples primitifs. Elle ne comprend pas non plus les motivations derrière les études de ces cultures, et donc ne discute pas non plus de l’importance de l’acculturation dans la poursuite des objectifs de la recherche anthropologique, qui serait réaliste dans son traitement, uniquement, si elle prenait en compte que le problème se trouve dans la connexion entre l’anthropologie scientifique et l’anthropologie appliquée. »
- Réinterprétation :
-
La notion de réinterprétation aussi centrale dans l’étude des processus d’acculturation. Elle nous permet de voir la manière dont une culture se transforme, les modalités à travers lesquelles les cultures s’influencent mutuellement tout en conservant leur spécificité.
- contre-acculturation :
-
À côté de la notion d’acculturation, il y a celle de contre-acculturation. = une réaction à une acculturation violente ou brutale. Un réflexe de conservation culturelle ou de revalorisation d’un trait culturel atteint par le changement.
Cf. Mouvement de la négritude. Mouvement artistique et littéraire. Années 30-40. Autour des écrivains L. S. Senghor, A. Cesaire et L. G. Damas. En réaction aux qualificatifs négatifs associés à la peau noire, à la racialisation du noir. Cela consiste en une réappropriation positive du mot nègre. Une réhabilitation des arts et des cultures négro-africaines ou d’origines négro-africaines.
Qu’est-ce que la culture
« Dans le langage de l’anthropologie, le mot « culture » a deux acceptions principales, qui ne sont d’ailleurs pas séparables l’une de l’autre, selon que l’on évoque « la » culture en général ou les formes de culture collectivement pensées et vécues dans l’histoire : on parle alors « des » cultures. »23
Tylor 1871 :
« Ensemble complexe incluant les savoirs, les croyances, l’art, les mœurs, le droit, les coutumes, ainsi que toute disposition ou usage acquis par l’homme vivant en société ».
Cela veut dire que la culture est humaine, qu’elle serait une condition à l’être humain vivant en collectivité. Lévi-Strauss parlera ensuite d’ »attribut distinctif ». C’est une caractéristique universelle à l’être humain, la culture s’opposant à la nature. La culture fit débat en anthropologie pendant longtemps et continue de faire débat quant à sa définition. Le dictionnaire de Bonte et Izard exprime que l’anthropologie américaine a tenté sans succès de créer un modèle pour définir la culture, mais sans succès, alors que les Anglais se focalisaient eux sur la notion de société. Pour les culturalistes américains, la recherche se serait développée « à partir d’une thématique privilégiant l’analyse des faits de « culture », alors que l’anthropologie « sociale », britannique notamment, portait une attention exclusive aux faits de « société ». » (Bonte et Izard),
Mais c’est sur la transmission que s’est alors tournée la réflexion anthropologique. D’où les travaux de Mead que nous avons vus un peu plus tôt. « Civilisation », « tradition », « coutume », « tradition culturelle », « héritage culturel », etc. sont des notions qui traduisent de la notion de transmission quand on parle de culture.
Comme nous l’avons vu avec les culturalistes lors de ce cours, ils considéraient que la personnalité était formée par la culture. C’est alors une question contemporaine qui stimula l’anthropologie, celle pour l’humanité du passage de la nature à la culture. Lévi-Strauss toujours s’essaya à cette question, d’où ses conclusions sur la prohibition de l’inceste, qu’il considérait universelle.
« L’anthropologie pose une interrogation qui peut être formulée ainsi : si l’unité de la condition humaine se résout en une pluralité de cultures, en quoi consistent les différences entre ces cultures ? Lévi-Strauss a donné à cette question une réponse opératoire en forme de définition : « Nous appelons culture tout ensemble ethnographique qui, du point de vue de l’enquête, présente, par rapport à d’autres, des écarts significatifs », et plus loin : « le terme de culture est employé pour regrouper un ensemble d’écarts significatifs dont les limites coïncident approximativement ». Nous sommes là au fondement d’un relativisme culturel dont la conception a été développée par Lévi-Strauss dans Race et Histoire (1952)(…). »24
-
Dans le développement de l’anthropologie, nous avons une évolution dans le traitement de cette notion de culture. D’abord pris dans sa globalité dans le but d’en déterminer à la fois l’universalité et la spécificité, avec le courant culturaliste, on aura les débuts d’une approche de la culture davantage axée sur sa spécificité. Ainsi, au sein de la culture globale d’une société, l’on distingue des cultures de groupes : culture ethnique, professionnelle, institutionnelle, culture jeune… = sous-cultures de Linton.
Et pour finir, une citation de Philippe Descola dans Par-dela Nature et Culture :
« C’est sans doute en premier lieu sous l’influence de l’éthologie, notamment celle des grands singes, que l’ontologie moderne a commencé à vaciller, lorsque fut mis en cause l’un de ses principes les plus communément admis, l’absolue singularité des humains en tant qu’espèce apte à produire de la différence culturelle. Les ethnologues ne semblent pas avoir pris encore la pleine mesure de cette révolution, et c’est pourtant à eux que s’adressaient William McGrew et Croline Tutin en 1978 lorsqu’ils publièrent dans Man, la prestigieuse revue britannique d’anthropologie sociale, un article iconoclaste où ils définissaient les chimpanzés comme des animaux culturels et plaidaient pour leur étude ethnographique comparative. »25
Conclusion
Je conclurai par les mots de Safietou Diack qui avait commencé à enseigner ce CM, et qui a fourni un excellent travail dans la préparation de ce cours. Pour reprendre le flambeau, j’ai écrit mon propre cours, mais le sien m’a permis de m’assurer que je ne m’égarais pas trop dans la construction de celui-ci. Sa conclusion est excellente et résume aussi son cours que le mien en y ajoutant ce qu’il manquait :
« La théorie culturaliste se propose d’aborder la façon dont la culture est présente en nous, la manière dont elle détermine nos comportements. Quelle est la part de notre personnalité qui relève de la culture ? A quel degré notre appartenance culturelle intervient dans la construction des personnes que nous sommes ? Un courant de pensée qui participe à ouvrir la collaboration de l’anthropologie avec d’autres disciplines. Ce qu’on reprochera au culturalisme, c’est de trop s’appesantir sur le déterminisme de la culture, sur l’influence de la culture sur les comportements que les individus développent. De plus, on releva vite les simplifications abusives de ses portraits « psychologiques » des sociétés étudiées. N’explique pas pourquoi telle culture choisit telle configuration, plutôt que telle autre, pourquoi telle culture choisit de valoriser telle qualité plutôt que telle autre. Le culturalisme cherche à distinguer des types culturels caractérisés par leur orientation globale, des modèles de cultures et leur finalité globale, c’est-à-dire le but que ces modèles poursuivent en cherchant à inculquer telle ou telle valeur, croyance… .
Pour distinguer ces modèles culturels l’analyse culturaliste :
-Étudie le processus de l’éducation (processus de socialisation)
-Définit le lien entre l’individu et la culture à laquelle il appartient (quel rapport l’individu entretient avec sa culture, est-ce un rapport de soumission, de réciprocité ? Est-ce que la culture exerce un déterminisme absolu sur les comportements individuels ? Ou est-ce que la culture influence l’individu en même temps que celui-ci participe à sa construction ?
-Étudie le processus de formation de la personnalité et ses caractéristiques culturelles (éléments de la personnalité des individus qui sont déterminés par l’appartenance culturelle). Comment notre personnalité se forme ? Quels sont les éléments présents dans notre personnalité et qui s’expliquent par notre appartenance culturelle. »
Bonus de terrain en Chine
La stratégie du jeu wéiqí 围棋
Ce qui est nommé « perdre la face », 丢面子 Diūmiànzi, j’ai réussi à le comprendre grâce à ma connaissance du jeu de Go, appelé Weiqi en Chine. Nous verrons dans la section qui suit celle-ci « Mon arrivée à l’université, le sentiment d’être attaqué », que c’est face à l’adversité que j’ai pu faire le lien entre les stratégies d’attitudes sociales et le Weiqi. Je connaissais le jeu de Go, de son nom japonais avant d’aller en Chine, je savais que ce jeu était d’origine chinoise, mais c’est le boum de la culture japonaise des années 90 qui a permis la connaissance du Go plus que du Weiqi en France. Encore aujourd’hui, beaucoup de personnes qui connaissent le jeu de Go ne savent pas que son origine est chinoise. J’aimerais présenter le Weiqi à des fins explicatives et imagées des interactions sociales que j’ai pu avoir en Chine, n’étant pas moi-même Chinois, ne communiquant pas en langue chinoise avec les protagonistes de mes terrains, mais où l’inconscient culturel est toujours présent. Ce que je nomme ici inconscient culturel, je l’identifie comme les schémas d’habitus que tout à chacun a programmé culturellement, dans une vision de construction culturelle de l’anthropologie. En Chine, il y a des règles de communications plus explicites qu’en France aujourd’hui, nommée culture sinisée par certains auteurs comme Léon Vendermeersch, qui explique la sinisation dans un article traitant de l’influence de la culture chinoise en Asie et dans le commerce et l’économie de quatre pays qui comprennent l’écriture idéographique chinoise : La Chine, le Vietnam, la Corée et le Japon :
« Ici intervient la deuxième idée, qui fait toute l’originalité du ritualisme confucéen, et qui est qu’au moins les comportements interpersonnels extérieurs, à l’occasion des circonstances marquantes de la vie sociale, peuvent faire l’objet de règles positives conçues pour les rendre bienséants ; moyennant quoi, à force d’être observées ne serait-ce qu’extérieurement – ce qui est d’autant plus facile –, ces règles finiront bien par être intériorisées en honnêteté foncière. » (…) «si les règles posées par la loi ne sont pas soutenues par une honnêteté foncière (suscitée par le rite), la loi sera détournée, alors que si l’honnêteté foncière est devenue une seconde nature (grâce à l’intériorisation des rites), même sans les lois elle incitera à agir comme il faut».26
Dans ce même article, l’écriture chinoise est expliquée comme ayant eu des origines et des utilisations différentes de celle de la communication en premier lieu : de divination puis d’outil gouvernemental, n’étant utilisée seulement pour les choses officielles. C’est le bouddhisme qui transforma l’utilisation de l’écriture graphique (ou sinographes) en une langue écrite, pour propager le bouddhisme en Asie. Toujours d’après Léon Vandermeersch, comme historiquement cette écriture fut la première écriture pour le Vietnam, la Corée et le Japon, et qu’elle fut en premier utilisée dans son utilité première d’outil de gouvernance, puis propagée aussi par le bouddhisme dans ces différents pays, l’économie grandissante de ces pays serait teintée de la sinisation.
« En tout cas, dans le « Nouveau Monde sinisé » d’aujourd’hui, du capitalisme libéral à la japonaise au capitalisme administré à la chinoise, les oppositions de régimes politiques me semblent encore plus atténuées par les proximités culturelles que lorsque je m’étais risqué à cette approche, il y a vingt ans. »27
Nous oserons parler de la relation sociale chinoise d’après notre expérience de terrain et de l’utilisation du jeu Weiqi ici. Ce jeu fut créé en Chine (771-453 av. J.-C.) puis, à la façon de l’écriture chinoise, s’est propagé dans les pays que nous avions cité ci-dessus, c’est-à-dire : la Corée et le Japon pour les deux autres pays connus pour leur grande maîtrise de ce jeu aujourd’hui. C’est dans la période historique chinoise nommée « la période des Printemps et Automnes »que ce jeu fut créé, la même période où vivait Confucius : 孔夫子 ; Kǒng Fūzǐ. Comment ai-je fait cette analogie ? En commençant par comprendre la relation de communication en Chine où la première règle est de ne jamais dire « non ». Ni oui, ni non, est un jeu facile à jouer pour un Chinois, car ces deux mots n’existent pas en mandarin. Cela peut paraître étonnant la première fois qu’on entend cela, difficilement imaginable pour des francophones ou toutes langues indo-européennes. Affirmer une réponse par oui ou non est quelque chose d’habituel pour moi qui aie comme langue maternelle le français. Alors comment dit-on oui ou non en chinois ? En reprenant le verbe de la question qu’on nous a posée :
« 你饿了吗? » Nǐ èle ma? = « Tu faim déjà ? » = « Est-ce que tu as faim ? »
– oui : « 我饿了。 » Wǒ èle. = « Je faim déjà. » = oui, j’ai faim.
– non : « 我不饿了。 » Wǒ bù èle. = « Je ne faim déjà. » = non, je n’ai pas/plus faim.
Dans cet exemple 不; bù est la particule de négation qui pourrait être traduite par « ne » quand le verbe indique un état, comme avec le verbe « être » 不是; Bùshì, mais celle-ci peut être remplacé par 没; Méi, quand le verbe indique une appartenance comme avec le verbe « avoir » 没有; Méiyǒu. En résumé, répondre à une question demande de reformuler la question dans une forme affirmative, positive ou négative. Il n’y a pas de mot seul pouvant remplacer le oui ou le non. Cette manière de composer une phrase, dans une relation de communication avec quelqu’un d’autre, amène à penser la phrase dans une stratégie de communication. Si l’on ajoute le fait qu’il est mieux entendu de ne pas répondre à la négative à une question où l’on nous demande quelque chose, par exemple de l’aide, ou dans une proposition qui ne vous plaît pas, la communication ne cesse de faire des détours. En Chine, il faut deviner quand une personne ne veut pas quelque chose, il y a des codes pour s’en rendre compte, et parfois, c’est un peu maladroit, car ne pas dire qu’on ne veut pas faire quelque chose avec quelqu’un passe bien souvent par les mêmes réponses trop connues comme :
« Tu veux venir manger avec moi ce soir ?
– J’aimerais bien, mais je suis tellement fatigué … »
Les excuses pour faire comprendre qu’on ne veut pas faire quelque chose sont parfois trop évidentes, et cela revient au même que de répondre simplement qu’on ne veut pas, et cela peut vexer l’interlocuteur. Alors, si la réponse négative est subtile, le plus souvent l’interlocuteur doit insister un peu, pour être sûr que la personne ne veut pas faire quelque chose, n’ose pas répondre oui, car cela fait partie de la politesse de refuser en premier lieu aussi. Les détours peuvent durer un certain temps, le temps de rester en bon terme quoi qu’il arrive avec son interlocuteur. Il peut y avoir de grands changements de sujet de conversation pour le bien de la bonne entente aussi, quand une personne est trop insistante sur une demande par exemple. Ce sont alors des stratégies d’évitement, comme si la personne tournait simplement la tête et déviait la question. Tout cela peut paraître un peu rude ou malpoli pour un Occidental qui ne voit pas d’un bon œil qu’on ne prenne même pas la peine de répondre à notre question. Beaucoup d’étrangers en Chine peuvent se vexer dans ce genre de conversation, ayant l’impression que la personne se croit supérieure et ne daigne pas répondre à une question. C’est pourtant plus subtil que cela, et cela permet, dans la communication chinoise, d’éviter d’entrer dans une conversation émotionnelle avec quelqu’un, même un ami. Cela m’arrive encore souvent avec des amis chinois avec qui nous pouvons avoir des échanges sur la politique ou des sujets délicats comme la MTC par exemple. On marche sur des œufs, et dans ces conversations, que j’ai en français ou en anglais, il faut toujours vérifier qu’on puisse dire ce qu’on veut dire ou non, et si l’on dépasse la limite où notre interlocuteur ne veut pas aller, il répondra stratégiquement pour se sortir d’avoir à répondre, sachant lui-même que nous ne sommes pas en accord, mais qu’il n’est pas la peine de l’exprimer. Nous finirons cette section de ce chapitre en présentant les règles de base du Weiqi, afin d’exprimer le plus justement possible comment nous en sommes arrivées à utiliser ce jeu pour pouvoir communiquer en Chine avec des Chinois.
Pierre Bonté, Michel Izard, sous la direction de, Dictionnaire de l’Ethnologie et de l’Anthropologie, Quadrige PUF, Paris, 2004.
Ruth Benedict, 1934, Pattern of Culture, Boston, Houghton Mifflin
CLEMENT E., DEMONQUE C., HANSEN-LOVE L. et KAHN P., Dictionnaire : La Philosophie de A à Z, Paris, Hatier, 2000
DESCOLA P., Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005
Désveaux, Emmanuel. « 4 – L’anthropologie américaine avant et après Boas », Franz Boas. Le travail du regard, sous la direction de Espagne Michel, Kalinowski Isabelle. Armand Colin, 2013, pp. 77-90.
Lenora Foerstel, Angela Gilliam (1994) Confronting Margaret Mead: Scholarship, Empire, and the South Pacific.
C. Jung, Commentaire sur le mystère de la fleur d’or, Albin Michel, 2021
Thomas S. Kühn, La structure des Révolutions Scientifiques, Paris, Flammarion, 1983, p. 45
Claude Lévi-Strauss, préface de, Marcel Mauss, Sociologie et Anthropologie, Quadrige/PUF, Paris, 1995 p. XXXI
Lévy-Bruhl L. (1931), Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive, Paris, PUF, 1963.p. 78-79
J.-P. Rioux, « Introduction : un domaine et un regard », dans Pour une histoire culturelle, J.-P. Rioux, J.-F. Sirinelli dir., Paris, 1997
Pierre Bonté, Michel Izard, sous la direction de, Dictionnaire de l’Ethnologie et de l’Anthropologie, Quadrige PUF, Paris, 2004, p. 188↩︎
Désveaux, Emmanuel. « 4 – L’anthropologie américaine avant et après Boas », Franz Boas. Le travail du regard, sous la direction de Espagne Michel, Kalinowski Isabelle. Armand Colin, 2013, pp. 77-90.↩︎
Ruth Benedict, 1934, Pattern of Culture, Boston, Houghton Mifflin↩︎
Désveaux, Emmanuel. « 4 – L’anthropologie américaine avant et après Boas », Franz Boas. Le travail du regard, sous la direction de Espagne Michel, Kalinowski Isabelle. Armand Colin, 2013, pp. 77-90.↩︎
Claude Lévi-Strauss, préface de, Marcel Mauss, Sociologie et Anthropologie, Quadrige/PUF, Paris, 1995 p. XXXI↩︎
Thomas S. Kühn, La structure des Révolutions Scientifiques, Paris, Flammarion, 1983, p. 45↩︎
Pierre Bonté, Michel Izard, sous la direction de, Dictionnaire de l’Ethnologie et de l’Anthropologie, Quadrige PUF, Paris, 2004, p. 112↩︎
Idem↩︎
CLEMENT E., DEMONQUE C., HANSEN-LOVE L. et KAHN P., Dictionnaire : La Philosophie de A à Z, Paris, Hatier, 2000, p. 25↩︎
Idem, p. 119↩︎
C. Jung, Commentaire sur le mystère de la fleur d’or, Albin Michel, 2021, p. 68↩︎
Ruth Benedict, Patterns of Culture, Houghton Mifflin Harcourt, 2005,pp. 290↩︎
Traduction personnelle.↩︎
Dictionnaire de l’Ethnologie et de l’Anthropologie, Quadrige PUF, Paris, 2004, p. 112↩︎
Lévy-Bruhl L. (1931), Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive, Paris, PUF, 1963.p. 78-79↩︎
Dictionnaire de l’Ethnologie et de l’Anthropologie, Quadrige PUF, Paris, 2004, p. 113↩︎
p. 281, as cited in: Lenora Foerstel, Angela Gilliam (1994) Confronting Margaret Mead: Scholarship, Empire, and the South Pacific. p. 84↩︎
Dictionnaire de l’Ethnologie et de l’Anthropologie, Quadrige PUF, Paris, 2004, p. 189↩︎
Idem p.1↩︎
Ibidem p. 322↩︎
Ibid p. 692↩︎
J.-P. Rioux, « Introduction : un domaine et un regard », dans Pour une histoire culturelle, J.-P. Rioux, J.-F. Sirinelli dir., Paris, 1997, p. 16.↩︎
Dictionnaire de l’Ethnologie et de l’Anthropologie, Quadrige PUF, Paris, 2004, p. 190↩︎
Idem p. 191↩︎
DESCOLA P., Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005, p. 253↩︎
Vandermeersch, Léon. « La nouvelle convergence du Monde sinisé. Entretien », Le Débat, vol. 153, no. 1, 2009, p. 81 ; Citant une parole de confucius↩︎
Idem p. 79↩︎