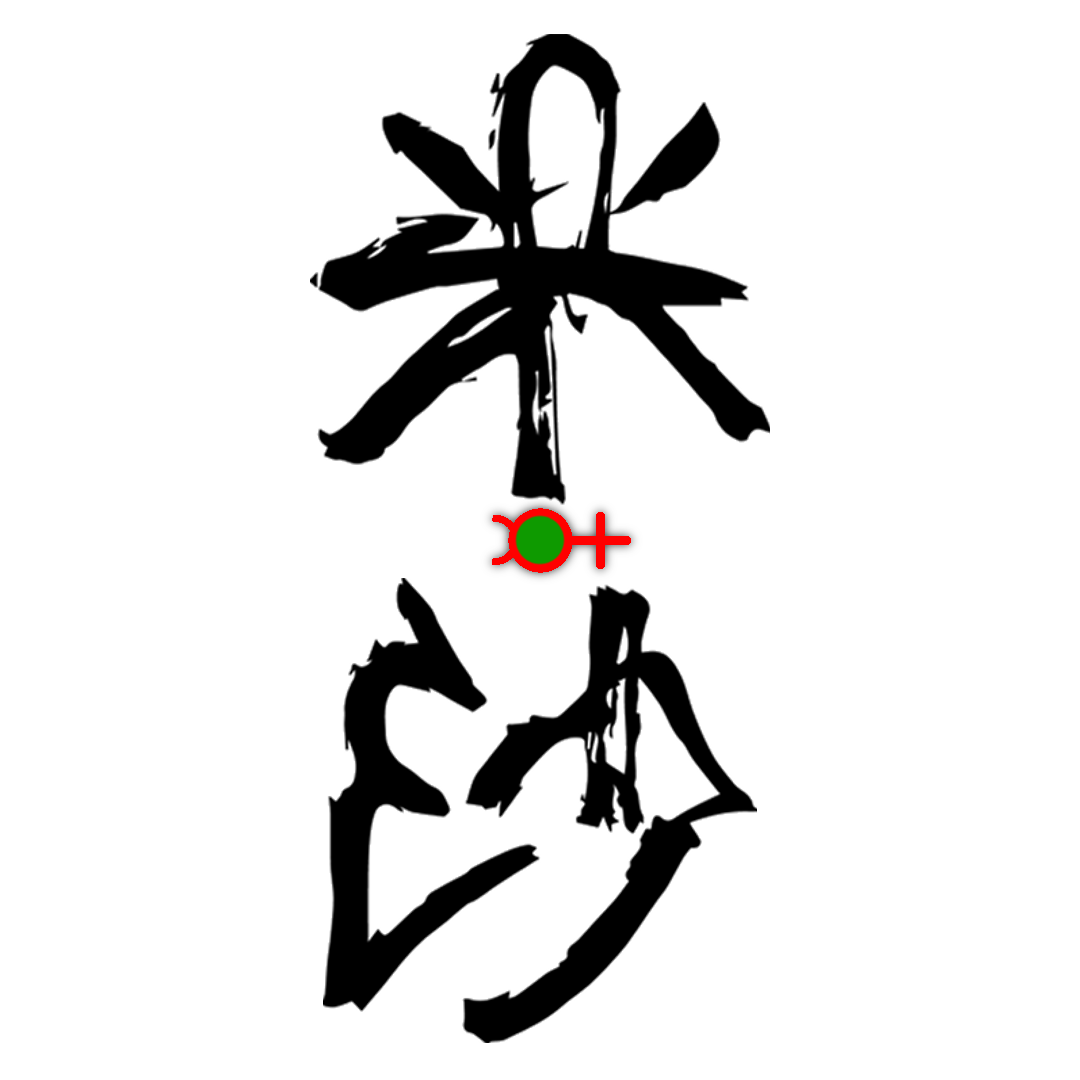Résumé
Bienvenue sur ma page de recherche.
Sur cette page je vous accueille dans ma recherche de doctorat, mais
plus encore, j’aimerais vous présenter mes projets de recherche ainsi
que mes futurs travaux.
Dernier article
Sentir le corps de l’intérieur : ethnographie d’une pratique de Zhineng Qigong avec projection d’images

Crédits : Marc Gutekunst, Lirethno SAS 2022
Référence électronique
Misha Schroetter, « Sentir le corps de l’intérieur : ethnographie d’une pratique de Zhineng Qigong avec projection d’images », Parcours anthropologiques [En ligne], 19 | 2024, mis en ligne le 01 mai 2024, consulté le 03 juin 2024. URL : http://journals.openedition.org/pa/2597 ; DOI : https://doi.org/10.4000/11rcm
Résumé
Notre ethnographie des méditations avec projection anatomique ou planches de méridiens
guidées par l’instructeur interroge la méthodologie d’enquête anthropologique.
Nous avons pris le parti d’une ethnographie de participation observante et de faire de ce
texte le lieu de l’exercice de notre réflexivité, tout en contextualisant notre propos grâce
aux retranscriptions des pratiques que nous avons vécues sur le terrain, les interventions
de l’instructeur, Marc Gutekunst, et de certains des participants au stage. L’objectif de
cet article est de partager l’essence de notre travail de ces huit dernières années, le
temps qu’il nous a fallu pour écrire une thèse de doctorat. En effet, les données exploitées
dans cet écrit viennent de nos observations de terrain lors du doctorat, mais sont de
première main, car jamais utilisées dans le contenu de la thèse. Nous insistons ici sur
la difficulté de témoigner de pratiques « internes », ou de conscience (Midol et Chenault,
2017).
Les notions clés transversales
réflexivité du chercheur, pratiques de conscience, phénoménologie, présent, durée, subjectivité, Qigong, Zhineng Qigong, ethnopraxie, imaginer, sentir.
Thèse de doctorat
La Trame et le Zhineng Qigong
Conscientisation des pratiques de conscience – Conscientisation des expériences vécues des pratiquants et praticiens du Zhineng Qigong et de la Trame
École Doctorale Sciences Sociales (ED 483)
Résumé
Cette thèse se situe dans le domaine des pratiques de conscience et porte sur la continuité établie par des acteurs chinois et français
de la Trame et du ZNQG. Ces deux pratiques sont l’objet d’un intérêt commun, d’un rapprochement des acteurs et ont été l’occasion de
développer des passerelles, influences réciproques, qui ont eu des effets sur leurs propres formes.
La Trame est une pratique appelée « technique vibratoire permettant d’agir sur la circulation de l’information dans notre organisme »
par l’association de la Trame, association garante d’une transmission inchangée depuis sa création par Patrick Burensteinas. Face à
de nombreux inconnus, ne serait-ce que dans cette définition de la Trame, et à un accroissement constant de ses praticiens formés en
France, nos premières observations nous ont mené à la découverte d’une seconde pratique de conscience : le Zhineng Qigong, qui était
pratiquée et enseignée par certains tramistes ou formateurs de la Trame de notre terrain.
C’est une recherche multisituée (Marcus, 1995), entre différents terrains en France, de Zhineng Qigong, enseigné par des instructeurs
français et chinois, et en Chine, lieu de formation de ses futurs enseignants. La Trame est, quant à elle, seulement enseignée en
France ; elle nous permettra une étude comparée entre les deux pratiques, mais surtout un nouveau point de vue, exprimé autrement que
dans les milieux du Qigong, mais témoignant des mêmes réalités vécues par les protagonistes de notre recherche.
Notre réflexion, lors de ce travail de recherche, commence par l’observation du corps d’un point de vue extérieur. C’était la piste
numéro un pour aborder le monde des pratiques de conscience. Le corps était ce qui semblait le plus simple à observer en premier lieu.
C’était sans compter toutes les questions qui vinrent à propos de la subjectivité. La partie corporelle de notre observation devait
passer par une ethnographie qui est de plus en plus employée, celle de la participation observante, ici de la pratique du chercheur
lui-même des pratiques observées. L’anthropologie « modale », empruntée à François Laplantine, nous permit l’analyse des activités
nombreuses et simultanées que vivent les Tramistes et les pratiquants de Zhineng Qigong. Regardant des corps lents et immobiles des
pratiquants, la notion « d’inconnu esthésiologique » de Richard Shusterman, nous parue pertinente et adaptée, face à l’apprentissage
de pratiques qui ouvrirent les pratiquants à un nouveau panel de sensations, inconnues a priori. Penser la reconfiguration de
l’appréhension de la réalité, prenant en compte l’impossibilité de connaître ce dont nous n’avons pas encore fait l’expérience est
l’apport de cette notion. C’est ici une question philosophique de tout temps, celle de la réminiscence dont parlait déjà Platon, et
que la phénoménologie de Merleau Ponty a appliquée aux sciences humaines depuis des décennies maintenant, questionnant le « faire
connaissance », dans une vision obstétrique de la pensée, de renaître sciemment pour passer de l’inconnu au connu. Observer la Trame
de l’extérieur est troublant, puisque seule une observation hyper précise des mouvements du corps nous permet de constater qu’il se
passe quelque chose, sous les mains du tramiste, et à l’intérieur de celui-ci, comprenant une activité cérébrale pouvant être intense,
que nous devinions d’abord, puis que les pratiquants confirmèrent lorsque nous les avons interrogés. Regarder de l’extérieur ne permettait
pas d’observer la Trame, simplement parce que nous ne regardions pas dans la bonne direction. La réalité vécue des tramistes s’entend dans
leur discours, mais faire le tri, lors de la captation des discours des tramistes, entre ce qu’ils vivent et ce qu’ils pensent avoir
vécu n’est pas une mince affaire. Cela nous conduisit à revoir notre problématique. Pratiquer nous-mêmes nous permit une nouvelle approche,
où notre propre expérience allait devenir le diapason, le référent sympathique, afin d’interroger les praticiens de la Trame. Parler
d’esthétique, dans son sens premier, d’Aesthésie, fut donc logique, dans la continuité de notre démarche d’ethnopraxie (Wacquant,
2000 : 7-8). C’est la question de la prise de conscience de l’expérience vécue qui arriva ensuite, empruntant à Bernard Andrieu et
Nicolas Burel, leur champ lexical du vivant et du vécu, suivant le sillon qu’ils avaient tracé, dans l’appréhension de la transcription
de la réalité vécue des informateurs de terrain, toujours dans l’observation du corps, mais en subjectivité. L’émersiologie, comme
concept permettant de faire « émerger » un vécu sensible, nous conduisit à observer l’interne, le micro-intérieur, la vie intérieure
des pratiquants et praticiens.
C’est une épistémologie de la prise de conscience du vivant, devenue vécue, par les pratiquants des deux pratiques en question, que
nous élaborerons lors de ce travail de thèse, où les briques fondamentales seront posées, nous permettant l’élaboration d’un outil
d’analyse et d’observation de la réalité vécue par les protagonistes de nos terrains, à savoir, comment accéder au témoignage de
cette réalité vécue. Enfin, l’examen de ces réalités vécues, s’imbriquant dans un mouvement contemporain, un milieu où sont proposées
ces pratiques de conscience, nous dirigera à considérer les changements que produisent ces disciplines sur les pratiquants,
personnellement, socialement, et les relations à soi et aux autres qu’un retournement du regard sur soi implique dans la pratique
de ces arts internes.
Les notions clés transversales
L’information, l’intention, l’expérimentation, l’imagination et le mimisme, sont les notions qu’il faut retenir dans une perspective comparative des deux pratiques observées.